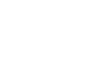John Lutz
John Lutz
Bon nombre d’universités, de facultés et de départements canadiens ont répondu au rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation par de nouveaux énoncés de mission visant à décoloniser ou à intégrer une culture autochtone dans le milieu universitaire et à raconter l’histoire du colonialisme au Canada et ailleurs dans une perspective autochtone, du moins en partie.
Au cours des quatre dernières années, le département d’histoire de l’Université de Victoria a expérimenté diverses façons de réaliser ces aspirations, en commençant par des étapes qui ne coûtent rien d’autre que du temps, et en transformant ces premiers succès en ressources qui nous ont permis de faire des pas importants. Certaines de ces idées peuvent être utiles à d’autres départements.
Notre première étape a été la formation, en 2016, d’un comité spécial au sein du corps professoral du département (qui comptait de 6 à 8 membres) qui était intéressé à répondre au rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. Après réflexion, nous avons eu l’idée de créer un tout nouveau cours sur des « sujets spéciaux » pour le semestre suivant, intitulé « La décolonisation de l’histoire canadienne ». Coordonné par Peter Cook, il s’agissait d’un cours d’une durée de trois heures chaque semaine, dont la première heure et demie était une conférence donnée par un conférencier invité autochtone ou non autochtone. La deuxième moitié était composée d’un séminaire avec les étudiants et l’invité ainsi que des lectures critiques pour compléter la présentation. Nous avons créé un cours non crédité pour la communauté autour des conférences publiques et nous avions une vingtaine « d’étudiants » de la communauté (surtout des retraités).
La deuxième innovation est née de la constatation qu’un grand nombre de professeurs et d’étudiants du département avaient déménagé pour travailler ou étudier à Victoria et qu’ils avaient très peu de connaissances ou de liens avec les populations autochtones locales. L’idée d’en savoir plus sur les peuples autochtones qui habitent le territoire où est située l’université semblait ainsi être un premier pas important. Nous avons communiqué avec la Première nation de Songhees, une guide a été identifiée, un autocar a été loué et la première « visite guidée des réalités coloniales en autobus » dirigée par Cheryl Bryce, détentrice des connaissances Songhees, a été offerte aux professeurs et aux étudiants du département selon le principe de recouvrement des coûts (30 $ pour les professeurs et 20 $ pour les autres). Toutes les places ont trouvé preneur. Depuis lors, le département organise deux visites de ce genre par année et a élargi sa liste d’invités par l’entremise de la Faculté des sciences humaines pour y inclure d’autres professeurs et étudiants diplômés en partenariat avec le Programme des études autochtones, le Centre for Global Studies et le Centre for Studies in Religion and Society. Plus de 400 ont participé à cette excursion depuis.
Notre troisième étape a été d’utiliser quelques centaines de dollars de fonds du département pour trouver des animateurs autochtones qui avaient déjà organisé un exercice des couvertures de Kairos pour les professeurs et les étudiants diplômés du département d’histoire. L’exercice d’une durée de deux heures permet aux participants de vivre un bref historique des relations entre autochtones et nouveaux arrivants au Canada. Des couvertures sur lesquelles se trouvent les participants sont retirées pour illustrer les pertes subies par les nations autochtones suite à une perte d’un territoire, l’arrivée d’une maladie, la création d’un pensionnat ou d’une réserve, etc…. Les participants qui constatent le petit nombre de couvertures qui restent à la fin de l’exercice sont profondément touchés par cette simple représentation. Notre université offre également un cours de formation sur l’acuité culturelle autochtone que plusieurs professeurs d’histoire ont suivi.
Notre quatrième étape a été d’utiliser des fonds de subvention provenant de l’un des projets de John Price et de nous associer à la Faculté des sciences humaines pour faire venir un chercheur autochtone invité à court terme. Nick Claxton, chercheur à la WSANEC, a été détaché de la Faculté du développement humain et social pour donner des conseils sur des projets de recherche et pour offrir un cours à 15 professeurs sur la décolonisation des bourses de la Faculté des sciences humaines les soirs et les fins de semaine.
La cinquième étape consistait à solliciter la Nation Songhees locale et lui proposer d’organiser conjointement avec elle une conférence axée sur les traités locaux signés en 1850. Cette offre a été accueillie avec enthousiasme par les Songhees qui ont offert d’organiser l’événement dans leur Centre de mieux-être dans leur réserve. La Temexw Treaty Association, dont font partie les Songhees, s’est engagée à réunir 150 participants des différentes communautés visées par le traité sur l’île de Vancouver. En 2017, cette conférence a réuni 300 participants – la moitié était composée de nouveaux arrivants locaux et l’autre, des membres de la communauté autochtone. Des conférenciers des deux groupes ont pris la parole. Dans le cadre de l’événement, des traductions des traités dans les langues locales Lekwungen et SENCOTEN ont été commandées et présentées aux Archives de la Colombie-Britannique où elles coexistent maintenant avec les traités écrits en anglais. Une série de capsules vidéo de la présentation et de renseignements sur les traités sont disponibles en direct sur le site Internet www.uvic-songhees.ca et un manuscrit de livre basé sur les articles a été accepté pour publication. Nous avons pu utiliser cette relation pour que des étudiants diplômés puissent entreprendre des projets avec les Songhees.
La sixième étape a été d’organiser plusieurs forums publics sur le campus et au centre-ville sur la question de savoir si nous devrions renommer les rues portant le nom de personnalités coloniales éminentes ou enlever des statues commémoratives. Différents membres de la faculté ont offert des biographies de quatre des personnages locaux les plus controversés : John A. Macdonald, James Douglas, Matthew Baillie Begbie et Joseph Trutch.
Finalement, nous avons pu utiliser ces activités, ainsi que notre école de terrain en ethnohistoire avec la nation Stó:lõ qui est en place depuis 20 ans, pour appuyer la demande de notre département pour obtenir un deuxième chercheur autochtone. Cela a porté fruit et notre département profite depuis juillet de l’expertise de Patrick Lozar sur l’histoire transfrontalière des Autochtones de la région de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Montana. Il complète le travail de Christine O’Bonsawin sur les membres de communautés autochtones dans le sport. Cela doublera le nombre de cours de premier cycle donnés par des historiens autochtones et accroîtra le dynamisme de notre enseignement supérieur.
Il reste beaucoup à faire. Dans la perspective de 2019-2020, notre comité spécial poursuit ses activités et prévoit organiser une réception à l’heure du dîner pour les étudiants autochtones sur le campus afin de les présenter et de les accueillir au département d’histoire. Nous avons une subvention de la Victoria Foundation pour étudier comment « décoloniser » les archives numériques de la communication entre les gouverneurs de la Colombie-Britannique et de l’île de Vancouver et le Bureau colonial. Nous explorerons de nouvelles options de financement pour faire venir un chercheur ou un aîné autochtone régulièrement à la Faculté des sciences humaines, nous tenterons d’offrir notre cours « Décoloniser le Canada » le plus régulièrement possible et demeureront aux aguets des nouvelles idées susceptibles d’émerger.