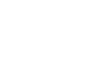Explorer la nature de la vérité
Alan Sears, Faculté d’éducation, Université du Nouveau-Brunswick
Dans un blogue précédent, je soulevais des questions sur le trop d’importance accordée aux objectifs économiques dans l’enseignement public, plus particulièrement en ce qui concerne la préparation des étudiants au travail. Je notais que les historiens et les professeurs d’histoire abordent souvent cette question en démontrant la valeur de l’étude de l’histoire comme préparation à un grand nombre de carrières. Je suis d’avis que nous sous-estimons ainsi l’histoire, et qu’il faudrait consacrer plus de temps et d’énergie à délimiter les avantages substantiels de l’étude historique pour d’autres domaines de la vie, notamment l’épanouissement humain et l’engagement civique informé et efficace. Dans ce texte, j’examine l’apport de l’histoire dans le développement d’idées plus complexes sur la nature de la vérité et dans le développement d’une compétence civique.
Dans son livre, The Death of Truth : Notes on Falsehood in the Age of Trump, Michiko Kakutani présente une image troublante de la société américaine qui s’enfonce dans un marécage de « nationalisme, tribalisme, éclatements, craintes de changement social et haine des étrangers ». Cette situation est due, selon elle, à une « attaque contre la vérité et la raison » qui a entraîné la perte « d’un sens de la réalité partagée et de la capacité à communiquer au-delà des clivages sociaux et sectaires ». [1] L’analyse dystopique de Kakutani est si férocement énoncée qu’il serait facile de la rejeter comme étant exagérée si elle n’était pas reprise par d’autres observateurs dans différentes sociétés du monde. Par exemple, après l’élection dans son pays au printemps 2017, la politologue française Nicole Bacharan a déploré l’état de la délibération civique dans des termes très similaires à ceux de Kakutani
Je n’ai jamais été aussi inquiète, aussi stressée et aussi choquée. Ce qui m’a le plus troublée, c’est la division du pays et la haine qui se dégage des groupes de personnes qui ne peuvent rien discuter, qui ne peuvent pas se comprendre, qui ne peuvent pas se parler… C’est comme s’ils ne parlaient même pas la même langue. [2]
Cette attaque perçue contre la vérité et la raison a également été explorée dans le programme de radio documentaire Ideas de la CBC, lors d’une émission d’une heure intitulée « The Truth About Post-Truth », et dans un article de la philosophe de l’Université du Texas Kathleen Higgins, qui a souligné que « les dictionnaires Oxford ont nommé « post-vérité » [3] comme leur mot de l’année 2016 ». [4] Je pourrais continuer à discuter du sujet, mais je pense en avoir assez dit.
Il n’est pas nécessaire d’observer de très près l’état du discours civique pour constater que, dans de nombreuses sociétés, les citoyens ont du mal à s’engager dans une discussion réfléchie et fondée sur des preuves concernant les valeurs et les questions publiques importantes. Dans leur étude longitudinale nationale sur les jeunes adultes en émergence (18-23 ans) aux États-Unis, Christian Smith et ses collègues ont constaté que la réflexion des participants sur des questions complexes se manifestait souvent « comme une idéologie simple d’esprit présupposant la construction culturelle de tout, un subjectivisme individuel, un léger antiréalisme ontologique et un relativisme moral absolu ». [5] Tous ces éléments ont contribué à l’incapacité et à la réticence des participants à s’engager dans un discours civique basé sur des questions complexes sur ce que pourrait constituer le bien commun et sur la façon dont celui-ci pourrait être mieux mis en œuvre par le biais de structures politiques et institutionnelles. Si, comme on le prétend souvent, encourager un engagement civique efficace et réfléchi est un objectif central de l’enseignement de l’histoire et de l’éducation civique, les faits montrent que c’est un échec lamentable.
Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Comme Penney Clark et moi le soutenons ailleurs, l’étude sérieuse de l’histoire a le potentiel d’aider les gens à développer « des idées plus complexes sur la vérité historique en particulier ainsi qu’une compréhension plus générale sur la nature de la vérité dans les affaires humaines et de sa relation avec les preuves et la perspective. L’étude de l’histoire démontre que si la vérité est toujours partielle, contextuelle et changeante, elle n’est ni infiniment flexible (relativisme absolu – tout est vrai) ni complètement insaisissable (cynisme absolu – rien n’est vrai) ». [6]
L’une des connaissances les plus importantes sur la nature de la vérité que l’on peut acquérir en étudiant l’histoire est l’idée que la connaissance, ou la « vérité », est un phénomène complexe qui se développe au fil du temps grâce à l’apport de diverses sources et perspectives. [7] Les gens sont souvent frustrés par ce qu’ils considèrent comme des conseils contradictoires de la part de soi-disant experts. Il semble que, presque chaque semaine, des chercheurs produisent une étude qui contredit ou remet en question les conclusions d’autres études. Pour beaucoup, cela remet en question toute la notion d’expertise ainsi que des concepts tels que la « pratique fondée sur les preuves » ou le changement « axé sur les données ».
Une partie du problème est que les gens veulent formuler des recommandations ou des orientations politiques à partir des résultats d’une ou deux études, ce qui ne constitue presque jamais une base solide pour agir. Les connaissances approfondies sont normalement le produit d’ensembles de travaux qui s’accumulent petit à petit et représentent des études réalisées selon des perspectives différentes et provenant de sources différentes. Cela est vrai, soit dit en passant, pour pratiquement tous les domaines de la connaissance humaine, et pas seulement pour l’histoire. Les historiens délimitent ce type de synthèse dans les chapitres historiographiques des mémoires ou des livres ; des chapitres qui font état des connaissances actuelles dans un domaine, établissant ainsi le contexte de leur propre travail qui pourrait contribuer, remettre en question ou faire avancer les idées reçues.
Les étudiants en histoire peuvent participer à des activités qui démontrent comment les connaissances historiques se développent, se consolident et évoluent avec le temps. Dans un de ses cours d’histoire au premier cycle, ma fille devait rédiger l’histoire intellectuelle d’une revue dans ce domaine. Elle était tenue de lire toutes les tables des matières sur une période de cinquante ans, ainsi qu’un certain nombre de résumés et un nombre plus restreint d’articles. Sur cette base, elle devait décrire les développements dans le domaine, y compris les questions examinées, les types de preuves utilisées, l’éventail des chercheurs impliqués et les domaines généraux de consensus et de contestation concernant la connaissance historique.
Le même genre d’exercice peut être fait au secondaire en utilisant une série de manuels scolaires qui amassent de la poussière sur une tablette. Je donne régulièrement aux étudiants une série de cinq manuels d’histoire utilisés dans les écoles du Nouveau-Brunswick entre les années 1940 et les années 2010. J’attribue un des manuels à chaque groupe d’étudiants et je leur demande de répondre à des questions telles que : Quelle est l’étendue et la séquence des sujets abordés dans le texte ? Quels sujets, idées ou thèmes semblent être les plus/moins importants ? Quelles personnes ou quels groupes sont inclus dans le texte et comment sont-ils présentés ? Y a-t-il des indications sur les convictions des auteurs ou des éditeurs quant à la façon dont les élèves apprennent l’histoire ? Une fois que chaque groupe a terminé cette tâche, je remanie les groupes afin que chacun d’eux ait un « expert » pour chacun des manuels et je demande aux nouveaux groupes de réfléchir : Comment les sujets, les questions ou les thèmes ont-ils changé ou sont-ils restés les mêmes au fil des ans ? Y a-t-il eu des changements dans les personnes ou les groupes présentés dans les textes et dans la substance de cette couverture ? L’approche de l’apprentissage de l’histoire par les élèves a-t-elle changé ? Comment pourrait-on expliquer les différents changements et les continuités ? Ces deux activités démontrent que la connaissance de l’histoire est fluide et changeante, et que ces changements reflètent, entre autres, de nouveaux corpus de preuves, de nouvelles questions de recherche, des universitaires divers travaillant selon des perspectives différentes, et des questions ou préoccupations actuelles qui nécessitent de comprendre le contexte historique.
Comme Penney Clark et moi le soulignons :
Si la communauté des historiens universitaires s’accorde largement sur le fait que la vérité historique est partielle et contingente dans le sens décrit ci-dessus, il existe également un engagement à l’échelle communautaire sur l’importance de fonder les prétentions à la vérité sur une analyse rigoureuse des sources primaires et secondaires. Les sources disponibles pour tout événement, époque ou ensemble d’idées étudié peuvent être utilisées pour étayer toute une série d’interprétations et de perspectives. Cependant, elles établissent également des paramètres qui excluent le soutien de certaines perspectives. Un engagement sérieux avec les sources permettra d’obtenir une gamme d’opinions, mais pas une gamme infinie. [8]
Ces types de compréhension sont importants dans de nombreux domaines de la vie au-delà de l’histoire et sont essentiels pour un discours civique informé. L’un des principaux objectifs de l’enseignement de l’histoire est donc de favoriser une compréhension plus approfondie de la nature de la connaissance et de la vérité et de faciliter l’utilisation de cette compréhension dans le cadre d’un engagement civique réfléchi.
[1] Michiko Kakutani, The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump (New York: Tim Duggan Books, 2018), 12 & 26.
[2] Cité dans Paul Waldie, “After Nastiest Presidential Campaign in Memory, France Faces Trump Moment,” Globe and Mail, 2017, https://www.theglobeandmail.com/news/world/after-shocking-campaign-french-face-profound-choice-to-upend-status-quo/article34907627/.
[3] Naheed Mustafa (Producer), The Truth About Post Truth (CBC Ideas, 2017), http://www.cbc.ca/radio/ideas/the-truth-about-post-truth-1.3939958.
[4] Kathleen Higgins, “Post-Truth: A Guide for the Perplexed,” Nature 540, no. 7361 (2016), 9, https://doi.org/10.1038/540009a. Pour une discussion plus élargie sur la crise de la vérité dans le discours public et ses implications pour l’enseignement de l’histoire, voir Penney Clark and Alan Sears, The Arts and the Teaching of History: Historical F(r)ictions, 1st ed. 2020 edition (London & New York: Palgrave Macmillan, 2020).
[5] Christian Smith et al., Lost in Transition: The Dark Side of Emerging Adulthood (New York: Oxford University Press, 2011), 15.
[6] Clark and Sears, The Arts, 250.
[7] Pour une plus longue discussion à ce sujet, consulter Alan Sears, “Negotiating the Maze of Educational Research,” Antistasis 1, no. 1 (2010): 25–27.
[8] Clark and Sears, The Arts, 255.