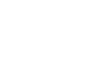Encourager le raisonnement civique
Alan Sears, Université du Nouveau-Brunswick
Cette série de blogues répond à la question suivante : pourquoi l’étude de l’histoire est-elle importante ? Dans le premier volet, je fais valoir que cette question est généralement abordée en expliquant comment l’étude de l’histoire établit une base de connaissances et de compétences nécessaires à toute une série de carrières productives et satisfaisantes. Bien que cela soit important, cela sous-estime sérieusement les objectifs humanisants et civiques de l’enseignement de l’histoire. Dans le deuxième blogue, je fais valoir que l’enseignement de l’histoire est un moyen efficace de favoriser les compréhensions complexes de la nature de la vérité et des preuves nécessaires à un engagement civique productif. Le texte qui suit s’appuie sur le second en explorant des aspects spécifiques du raisonnement humain qui font obstacle à un engagement réfléchi sur des questions importantes. Je soutiens que l’enseignement de l’histoire peut résoudre ce problème en favorisant ce que j’appelle le raisonnement civique.
Dans le blogue précédent, je soulignais que, pour les historiens, la connaissance ou la vérité naît d’une attention particulière et d’une analyse fidèle des preuves, combinées à la présentation et à la discussion des résultats dans des forums publics de différentes sortes. À un certain niveau, il semble évident de dire que la connaissance humaine émerge de ce genre de processus rationnel, mais une pléthore de travaux récents en science cognitive indique que les humains ne s’intéressent, ni aux preuves, pas plus qu’aux arguments logiques de façon naturelle [1] (https://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-minds). Le manque d’espace ne me permet pas de faire un examen complet de ces travaux, mais un résumé indique que lorsqu’il s’agit de raisonner, nous sommes paresseux (nous avons tendance à trop simplifier et à porter des jugements rapides), partiaux (notre pensée est limitée par nos cadres cognitifs et nous n’aimons pas changer d’avis), hubristiques (nous pensons en savoir beaucoup plus que nous connaissons) et partisans (nous adaptons notre pensée à ce que, nous croyons, plaira à nos proches). Tous ces facteurs nous empêchent d’utiliser de façon précise, réfléchie et honnête les preuves et les arguments et conduisent souvent à ce que « des personnes très intelligentes [prennent] des positions qui ne sont pas fondées sur des preuves ». [2] Cette évolution des caractéristiques de notre raisonnement mettent en place un ensemble de dichotomies qui rendent la vie démocratique difficile (voir tableau 1).
Tableau 1: Les dichotomies du raisonnement

Dans son livre Too Dumb for Democracy ? Why We Make Bad Political Decisions and How We Can Make Better Ones (https://gooselane.com/products/too-dumb-for-democracy), le politologue canadien David Moscrop s’appuie sur des travaux similaires en science cognitive pour affirmer que les êtres humains ne sont pas naturellement adaptés au raisonnement démocratique. « Notre révolution cognitive », écrit-il, « n’a pas été en mesure de suivre notre évolution sociale, politique, culturelle et technologique ». [3] Un bon enseignement de l’histoire peut aborder toutes les dichotomies de la raison décrites ci-dessus d’au moins deux façons : il peut fournir des exemples historiques pour illustrer chacun des aspects du raisonnement naturel et civique et explorer les conséquences de ceux-ci dans les affaires humaines ; et il immerge les étudiants dans des processus conçus explicitement pour contrer les tendances naturelles à la simplicité, aux préjugés, à l’arrogance et à la partisannerie afin de favoriser les orientations plus complexes du raisonnement civique.
Dans leur livre, The Enigma of Reason (https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674237827), Hugo Mercier et Dan Sperber donnent plusieurs exemples historiques de ce qu’ils appellent « mon parti pris » [4] qui façonne d’importantes questions publiques. L’un d’entre eux est le travail d’Alphonse Bertillon, « l’un des policiers et experts en science judiciaire les plus respectés au monde », [5] qui a été chargé par le gouvernement français d’enquêter sur l’affaire Dreyfus à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Malgré sa formation et son expérience, Mercier et Sperber soutiennent que le cadre cognitif préexistant de Bertillion l’a mené à manipuler les preuves afin de faire condamner Dreyfus. Il est intéressant de noter que l’émergence de nouvelles preuves convaincantes ne l’a pas amené à modifier son point de vue, au contraire, il l’a ajusté pour qu’il corresponde à ses conceptions originales. Pour Mercier et Sperber, l’argumentation est un moyen essentiel de perturber son parti pris. Ils écrivent : « le raisonnement se développe dans le va-et-vient de la conversation, lorsque les gens peuvent échanger des arguments et des contre-arguments ». [6] Ce cas illustre la façon dont la tendance humaine au raisonnement biaisé, même chez les professionnels bien formés et expérimentés, fonctionne dans les affaires humaines. Elle soutient également une approche de l’enseignement de l’histoire qui engage les étudiants dans une argumentation sur la nature des preuves et les conclusions qui en sont tirées, comme un moyen de favoriser un meilleur raisonnement.
L’enseignement de l’histoire peut également amener les étudiants à débattre de questions et de problèmes complexes. Trop souvent, les cours d’histoire se concentrent sur ce que Howard Gardner (https://www.routledge.com/The-Development-and-Education-of-the-Mind-The-Selected-Works-of-Howard/Gardner/p/book/9780415367288) appelle le « compromis de la bonne réponse », selon lequel un enseignant transmet des informations fixes et les étudiants sont censés les répéter lors des tests et des devoirs. Ceci est souvent au service de la « couverture » que Gardner appelle « le plus grand ennemi de la compréhension ». [7] Gardner préconise d’encourager les étudiants à utiliser des documents à partir de perspectives multiples « d’une manière qui leur est agréable au départ mais qui les met éventuellement au défi ». [8]
Inviter les étudiants à utiliser un éventail de sources primaires et secondaires pour aborder des questions historiques importantes est une façon de faire exactement ce que suggère Gardner. Au départ, les étudiants trouvent souvent les sources primaires intéressantes et amusantes, mais s’ils abordent d’importante questions, ils ne tarderont pas à reconnaître que les sources sont souvent incomplètes, parfois contradictoires et régulièrement assez obscures. Ils devront s’engager à localiser les sources, les interpréter, les analyser, les mettre en contexte, élaborer des conclusions initiales, présenter des idées, faire face à un examen minutieux et repenser les postulats. Ce sont tous des processus assez typiques de la recherche historique, et conformes au raisonnement civique décrit ci-dessus.
En réfléchissant à sa longue carrière d’enseignant d’histoire, Ken Osborne (https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/chr.93.1.108) fait remarquer qu’un tournant s’est produit pour lui à l’université lorsqu’on lui a demandé de mener sa propre enquête sur une question historique en utilisant des sources primaires. Cet exercice a fondamentalement changé sa propre opinion sur la nature de l’histoire, la vérité historique et la méthode historique. Il poursuit en disant : « Il est justifié d’exiger de toute personne qui envisage d’enseigner l’histoire qu’elle fasse un travail original de ce type, aussi limité soit-il dans sa portée. Il n’y a pas de meilleur moyen d’apprendre ce que comporte faire une enquête dans la discipline de l’histoire ». [9] Je pense qu’Osborne est trop modeste dans sa recommandation. Ce ne sont pas seulement les futurs professeurs d’histoire qui doivent faire l’expérience du type d’enquête qu’offre l’histoire, mais tous les citoyens.
L’historien Jonathan Zimmerman et la philosophe Emily Robertson (https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo25956793.html) postulent que le fait de travailler avec des preuves et des arguments peut favoriser une meilleure délibération civique. [10] Ils, et bien d’autres, expliquent en détail comment l’examen de questions contestées, la lutte contre les preuves et l’apprentissage de la nature de l’expertise peuvent améliorer la capacité des étudiants à s’engager dans un discours civique productif fondé sur une compréhension complexe de la nature partielle, changeante et contingente du savoir. L’enseignement de l’histoire à tous les niveaux devrait engager les étudiants dans ces processus afin de favoriser « l’acte contre nature » du raisonnement civique. [11]
[1] Voir comme example, Bethany Albertson & Shana Kushner Gadarian, Anxious Politics: Democratic Citizenship in a Threatening World (New York: Cambridge University Press, 2015). Steven Sloman & Philip Fernbach, The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone (New York: Riverhead Books, 2017). Hugo Mercier & Dad Sperber, The Enigma of Reason (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017). Howard Gardner, The Development and Education of the Mind: The Selected Works of Howard Gardner, World Library of Educationalists Series (London and New York: Routledge, 2006).
[2] Sara E. Gorman & Jack M. Gorman, Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us (New York: Oxford University Press, 2017), 4.
[3] David Moscrop, Too Dumb for Democracy? Why We Make Bad Political Decisions and How We Can Make Better Ones (Fredericton, NB: Goose Lane Editions, 2019), 46.
[4] Mercier and Sperber, The Enigma, 292.
[5] Mercier and Sperber, 236.
[6] Mercier and Sperber, 270.
[7] Gardner, The Development, 148.
[8] Gardner, 148.
[9] Ken Osborne, “A History Teacher Looks Back,” The Canadian Historical Review 93, no. 1 (2012): 108–37, 120.
[10] Jonathan Zimmerman & Emily Robertson, The Case for Contention: Teaching Controversial Issues in American Schools (Chicago & London: University of Chicago Press, 2017).
[11] Sam Wineburg décrit la pensée historique comme un acte contre nature, c’est-à-dire un ensemble de processus appris dans lesquels les humains ne s’engagent pas normalement. Je lui emprunte cette expression et l’utilise ici dans le même sens. Samuel S. Wineburg, Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past (Philadelphia: Temple University Press, 2001).