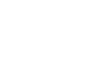Débattre des questions de l’heure
Alan Sears, Université du Nouveau-Brunswick
Cette série de blogues cherche à articuler les raisons humanisantes et civiques de l’enseignement de l’histoire. Dans le premier texte, j’affirme que les historiens et les professeurs d’histoire tombent souvent dans le piège de justifier l’étude de l’histoire en fonction de son utilisation dans la préparation à l’emploi. Bien que cela ne soit pas négligeable, mon point de vue est que l’histoire est bien plus précieuse pour ses contributions à l’épanouissement humain en général et à l’engagement civique en particulier. Le deuxième texte soutient que l’étude historique peut favoriser une compréhension plus nuancée et plus sophistiquée des preuves et de la vérité, tandis que le troisième souligne le potentiel de l’histoire à contribuer au développement d’aspects spécifiques du raisonnement civique. Cet article montre que l’étude de l’histoire est d’une importance capitale pour un engagement informé et réfléchi sur les questions d’actualité. Elle peut le faire de plusieurs façons, notamment les quatre qui sont examinées ci-dessous.
Offrir un contexte important pour les questions contemporaines
Au moment où j’écris ces lignes, la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est en proie à des tensions résultant d’un conflit entre les pêcheurs de homards autochtones et non autochtones. Ce conflit s’est manifesté, entre autres, par des manifestations, des blocus et la destruction de biens. Il a suscité une importante couverture médiatique et une grande angoisse politique. Après ce qui a semblé être un lent départ, différents niveaux de gouvernements ont commencé à réagir et tentent de trouver une solution au problème.
Sans tenir compte des contextes historiques de ce désaccord, il est impossible de parvenir à une solution complète et à un certain degré de guérison dans les communautés concernées. Ce désaccord n’a pas commencé lorsque la Première nation Sipekne’katik a lancé sa pêche au homard autoréglementée le 17 septembre 2020, mais a de longs antécédents historiques touchant de multiples époques et des événements et actions spécifiques. Il s’agit notamment des premiers traités de paix et d’amitié signés entre la Couronne britannique et les Wabanaki du Canada atlantique au XVIIIe siècle, des tensions liées à l’utilisation des ressources depuis ces traités, des décisions juridiques du XXe siècle sur les implications de ces traités, en particulier le jugement Marshall en 1999 (https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100028614/1539611557572), et de l’histoire d’autres litiges et accords qui découlent de ce jugement.
Le contexte historique peut aider les personnes concernées à comprendre les éléments sociaux, juridiques et institutionnels complexes de la question. Il peut également permettre de comprendre comment les différentes communautés concernées en sont arrivées là, quel est le rôle qu’a joué cette ressource dans leur vie individuelle et communautaire dans le passé, et ce qu’elle signifie sur le plan culturel et économique aujourd’hui. Ce type de compréhension jette les bases de l’empathie civique, qui est essentielle pour résoudre tout conflit difficile.
Il est essentiel que les leaders communautaires chargés de trouver des solutions connaissent un peu cette histoire, mais cela n’est pas seulement important pour les dirigeants. Les solutions à des problèmes durables comme celui-ci exigent l’adhérence et l’engagement à long terme des personnes et des communautés concernées. La participation civique de tous les citoyens et la santé de la société civile sont renforcées par une meilleure compréhension des contextes historiques des problèmes contemporains.
Favoriser une meilleure compréhension des concepts et principes civiques clés
Au cœur de toutes les questions publiques importantes se trouvent des questions sur la manière dont les concepts ou principes clés se concrétisent dans les institutions et les processus de la vie civique. La réflexion sur ces questions est donc enrichie lorsque les citoyens ont une compréhension plus complexe des concepts et des principes concernés, et la connaissance de l’histoire est essentielle pour développer ce type de compréhension.
La première chose que les citoyens doivent savoir sur les concepts et principes démocratiques est qu’ils sont contestés et fluides. C’est-à-dire que nous nous interrogeons sur ce qu’ils signifient et la manière dont ils devraient être mis en œuvre, et que les significations, politiques et pratiques qui en découlent changent au fil du temps et selon les contextes. Prenons l’exemple du principe démocratique le plus fondamental, le gouvernement par le peuple. Il ne suffit pas de connaître ce principe et d’y croire, nous devons également aborder plusieurs autres questions : Qui sont les personnes qui composeront ceux qui gouvernent ? Comment cette règle sera-t-elle exercée ? Aucune démocratie dans l’histoire n’a inclus tout le peuple avec ceux qui gouvernent, et tous les peuples ont développé des institutions et des pratiques pour mettre en œuvre ce principe. Les restrictions imposées à ceux qui participent et les mécanismes de participation ont été et continuent d’être contestés et sont en constante évolution.
Lorsqu’on demande aux citoyens contemporains si le vote doit être abaissé aux jeunes de seize ans ou s’il faut proposer des changements au système électoral, ils se joignent à une conversation sur le principe du gouvernement par le peuple et sur la façon dont ce principe est mis en œuvre à notre époque et dans notre pays. Cette conversation serait grandement enrichie en tenant compte de la manière dont d’autres ont réfléchi et mis en œuvre ce même principe à des époques et dans des contextes différents. Il s’agit d’un élément clé de la connaissance civique complexe, comme l’illustre la figure 1. L’idée étant que de pouvoir décrire les attributs essentiels de tout concept ou principe ne constitue que le premier niveau de la connaissance. Les citoyens réfléchis comprennent comment ces concepts et principes ont été formulés et mis en œuvre au fil du temps, les tensions inhérentes à l’élaboration de ceux-ci, et peuvent exprimer une position éclairée basée sur ces connaissances et agir en fonction de cette position. [1] L’étude de l’histoire joue un rôle important dans le développement de ces connaissances complexes.
Tableau 1 : Connaissances civiques complexes

Évaluer les arguments de ceux qui utilisent l’histoire pour promouvoir des approches particulières de politique publique
En mars 2015, Justin Trudeau, alors chef du troisième parti à la Chambre des communes, a prononcé un important discours à l’Université McGill de Montréal (https://www.macleans.ca/politics/for-the-record-justin-trudeau-on-liberty-and-the-niqab/). Dans ce discours, il contestait la position du Premier ministre Stephen Harper sur la question de savoir si Zunera Ishag, une immigrée musulmane au Canada, devait avoir la permission de porter le niqab lors de sa cérémonie de citoyenneté (https://www.thestar.com/opinion/commentary/2015/03/16/why-i-intend-to-wear-a-niqab-at-my-citizenship-ceremony.html). Le Premier ministre considérait qu’il était obligatoire que Mme Ishag montre son visage tandis que M. Trudeau a exprimé son désaccord avec véhémence et a utilisé trois références historiques spécifiques pour caractériser la position du Premier ministre. Il a déclaré : « Ce n’est pas dans l’esprit de la liberté canadienne, mes amis. C’est dans l’esprit du Komagata Maru. Du St. Louis. De « aucun, c’est encore trop ». [2]
Comme Penney Clark et moi-même le soutenons ailleurs, l’invocation de ces exemples par M. Trudeau n’était pas seulement une tentative d’illustrer sa position sur la question de savoir s’il était approprié ou non de porter un niqab lors de la prestation d’un serment de citoyenneté, mais aussi une tentative de lier le Premier ministre Harper à la xénophobie virulente associée aux trois références. Il n’y a pas de place ici pour discuter des mérites spécifiques de l’analogie, mais la technique de M. Trudeau utilise clairement l’histoire comme moyen pour contester à la fois la position et le caractère de son adversaire. Il prend trois événements ou politiques historiques complexes et nuancés et les utilise de manière simpliste sans fournir de contexte ou de preuves spécifiques pour étayer ses affirmations. Pour être clair, M. Trudeau n’est pas le seul coupable, c’est quelque chose que les politiciens et autres personnes font tout le temps. C’est un exemple de ce que l’historienne Margaret MacMillan appelle « les utilisations et les abus de l’histoire ». [3] Elle écrit que les humains « tentent de faire dire des choses aux événements historiques pour montrer que nous avons toujours tendance à bien nous comporter et nos adversaires à mal se comporter, ou que nous avons normalement raison et les autres tort ». [4]
L’histoire est souvent invoquée par ceux qui cherchent à faire la lumière sur les événements contemporains ou pour formuler une solution politique particulière. Comme je l’indique dans la section sur le contexte précédent, elle est souvent très utile pour offrir des perspectives qui peuvent éclairer les problèmes et indiquer des voies possibles pour l’avenir. L’étude historique peut aider à préparer les citoyens à évaluer dans quelle mesure les références et les illustrations historiques sont utiles pour mieux comprendre les questions contemporaines et où elles sont utilisées comme des slogans superficiels pour rallier des appuis à une cause particulière.
Reconnaître et faire face aux obligations du passé
Le passé lui-même est aujourd’hui une question d’intérêt public dans de nombreux pays, dont le Canada. Comme le souligne Elizabeth Cole, « dans la plupart des sociétés qui se rétablissent de la violence, la question de savoir comment faire face au passé est aiguë, surtout lorsque le passé implique des souvenirs de mort, de souffrance et de destruction si répandus qu’un pourcentage élevé de la population est touché ».[5] Elle poursuit en énumérant une série de réponses de politique publique aux passés difficiles, notamment :
la reconnaissance officielle du préjudice subi ; les excuses officielles et autres gestes officiels ; la promotion de forums publics d’établissement des faits ou de vérité (tels que les commissions de vérité ou historiques), y compris une plate-forme pour les victimes ; le paiement de réparations ou l’octroi de restitutions ; la justice sous forme de procès ou de lustration ; l’établissement de l’état de droit ; les gestes publics de commémoration par la création de monuments, de commémoratifs et de fêtes, et d’autres activités éducatives et culturelles ; la réforme institutionnelle et le développement à long terme ; et enfin la délibération publique. [6]
Depuis les excuses présentées aux survivants canadiens japonais de l’internement de la Seconde Guerre mondiale et à leurs familles en 1988, le Canada est disposé à considérer et à mettre en œuvre la plupart de ces types de réponses en ce qui concerne un certain nombre de phénomènes historiques.
Dans leur livre, The Big Six Historical Thinking Concepts, Peter Seixas et Tom Morton discutent de la complexité des jugements de valeur éthiques sur le passé, y compris le problème du présentisme, et définissent un ensemble de repères pour que les étudiants apprennent à « porter un jugement éclairé sur les questions contemporaines » liées aux atrocités et/ou aux injustices passées. [7] Dans le contexte actuel des délibérations en cours sur la manière de traiter l’héritage du colonialisme dans de nombreux aspects de la société, il serait difficile d’imaginer un rôle plus important pour l’enseignement de l’histoire au Canada aujourd’hui.
Pour reprendre les célèbres paroles du romancier américain William Faulkner : « Le passé n’est jamais mort. Il n’est même pas passé. » [8] Le passé est en effet intrinsèquement présent dans les questions auxquelles nous sommes confrontés en tant que société aujourd’hui. Reconnaître ce fait, le comprendre et s’en inspirer pour réfléchir à la manière de favoriser le bien commun est une exigence de citoyenneté réfléchie, et l’entretien de ces capacités devrait être un axe essentiel de l’enseignement de l’histoire.
[1] Pour une plus ample discussion à ce sujet, voir Andrew S. Hughes & Alan Sears, “Situated Learning and Anchored Instruction as Vehicles for Social Education,” dans Challenges and Prospects for Canadian Social Studies, ed. Alan Sears and Ian Wright (Vancouver: Pacific Educational Press, 2004), 259–73.
[2] Aaron Wherry, “For the Record: Justin Trudeau on Liberty and the Niqab – The Text of Justin Trudeau’s Controversial Speech,” 2015, http://www.macleans.ca/politics/for-the-record-justin-trudeau-on-liberty-and-the-niqab/.
[3] Penney Clark & Alan Sears, The Arts and the Teaching of History: Historical F(r)Ictions, 1e édition 2020 (London & New York: Palgrave Macmillan, 2020), 246.
[4] Margaret MacMillan, The Uses and Abuses of History (Toronto, ON: Viking, 2008), 103.
[5] Elizabeth A. Cole, “Introduction: Reconciliation and History Education,” in Teaching the Violent Past: History Education and Reconciliation, ed. Elizabeth A. Cole (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2007), 1.
[6] Cole, 7.
[7] Peter Seixas & Tom Morton, The Big Six Historical Thinking Concepts (Toronto: Nelson Education, 2013),
[8] William Faulkner, Requiem for a Nun (New York: Random House, 1951).