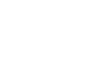Récent.e.s lauréat.e.s
Le prix Wallace-K.-Ferguson
David Levine, At the Dawn of Modernity: Biology, Culture, and Material Life in Europe after the Year 1000. University of California Press, 2001.
Dans une vaste synthèse, David Levine affirme que la modernité aurait pris racine dans le nord-ouest de l’Europe au cours des trois premiers siècles de l’an 1000. Le livre décrit sur quel fond social complexe s’est effectuée la transition entre le monde antique et le monde moderne, avant que la peste noire ne vienne tout bouleverser en 1348. Dans cet ouvrage que le comité a qualifié de «magistral», un terme malheureusement trop souvent galvaudé, David Levine aborde son analyse de la transformation sociale à partir de deux perspectives différentes. D’une part, il s’intéresse aux changements sociaux qui proviennent de la base de la société et qui touchent les relations démographiques structurant la vie courante, la formation des mariages et des familles, la lutte pour la survie quotidienne dans une économie prémoderne incapable de répondre aux besoins de larges populations, et le recours, par les familles de paysans, à de multiples stratégies de survie. D’autre part, l’auteur observe les changements qui ont été enclenchés par le haut de la société : la Réforme grégorienne, qui favorisa la montée d’un christianisme public et agressif, la consolidation d’une élite politique et de la centralisation étatique, ainsi que la reproduction du féodalisme et son impact sur la vie sociale. En général, le raisonnement de David Levine suit des pistes plus ou moins organisées autour de thèmes ayant trait aux économies biologiques, culturelles et matérielles qui ont marqué l’aube de la modernité. Le livre est émaillé de nombreuses et judicieuses juxtapositions. L’évolution continue de la modernisation naissante fut brusquement interrompue et réorientée lorsque frappa la peste noire, qui emporta une grande partie de la population en Europe. La reconstruction sociale se fit alors à l’intérieur d’un nouveau cadre de liberté et dans un contexte de «désespoir exubérant», où toutes les vérités absolues furent remises en question. La peste noire fut donc l’exterminatrice d’un ancien ordre, mais elle provoqua une série de changements sociaux au cours desquels les anciennes structures allaient se modifier et prendre de nouvelles caractéristiques; on assista ainsi à une intensification de la division du travail, au développement des structures étatiques, à la désintégration du féodalisme, et surtout, à l’essor d’une nouvelle définition du sacré pendant la Réforme. Le comité a été particulièrement impressionné par la prose éloquente de David Levine, par ses gracieux compromis aux susceptibilités postmodernes, par l’éclectisme de sa technique multidisciplinaire, par son utilisation adroite de la théorie et par l’étendue de son savoir. Tout historien trouvera ce livre passionnant. Il nous est rarement donné de lire avec autant de plaisir un ouvrage d’une telle importance.
Mentions honorables :
Joy Dixon, Divine Feminine: Theosophy and Feminism in England. John Hopkins University Press, 2001.
Dans son excellente étude Divine Feminine: Theosophy and Feminism in England, Joy Dixon explore les liens unissant les croyances spirituelles, la race et le sexe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. L’auteure a fait des recherches fouillées dans les dossiers de la Theosophical Society conservés en Angleterre et en Inde, et elle a pu ainsi suivre le développement de ce mouvement théosophique, depuis le moment où il était surtout dominé par les hommes, jusqu’à ses rapports plus tardifs avec les féministes anglaises et les suffragettes. Les femmes ont essayé d’étendre leur influence spirituelle dans le domaine public et politique en recourant à la fois aux principales religions et à une spiritualité alternative; les militantes féministes embrassaient la théosophie pour la force spirituelle qu’elle leur apportait. Joy Dixon montre qu’elles étaient également séduites par le dualisme inhérent aux croyances théosophiques. De plus, l’auteure fait la démonstration qu’une analyse de la théosophie – qui fut adoptée par les Occidentaux, mais qui tire ses origines du mysticisme oriental – permet de mieux comprendre les idées qui avaient cours, à la fin du XIXe siècle, sur la race et les rôles sexuels. En mettant l’accent sur la nature dualiste de la théosophie, l’auteure présente sous un nouvel angle les assises du discours des suffragettes sur l’égalité politique; elle propose aussi une explication intéressante des différentes formes de confusion des genres et elle présente une nouvelle interprétation de l’attitude ambivalente des Britanniques envers les membres de leur empire indien. L’écriture de Joy Dixon est claire et fascinante. L’auteure utilise très efficacement les études de cas pour illustrer comment certaines féministes ont endossé la cause théosophique. La force du livre réside toutefois dans sa façon pénétrante et sensible de traiter des croyances d’une spiritualité alternative.
Elizabeth Rapley, A Social History of the Cloister. Daily Life in the Teaching Monasteries of the Old Regime. McGill-Queen’s University Press, 2001.
Depuis toujours, l’histoire du christianisme s’est écrite au masculin, si tant est qu’il ne semblait y avoir nul besoin de parler de l’autre moitié du monde. Sans doute existait-il des monographies sur tel ou tel couvent, tel ou tel ordre religieux, des biographies, souvent des hagiographies d’ailleurs, sur telle ou telle religieuse, bienheureuse ou sainte, mais ce n’étaient là que choses éparses qui ne s’inscrivaient guère dans le cadre plus général d’une histoire du fait religieux. Et surtout, ces travaux n’accordaient aux femmes, laïques ou religieuses, qu’un rôle épisodique, voire dérisoire. Depuis quelques années, des travaux de haute valeur se sont multipliés qui, avec une méthodologie renouvelée et des perspectives plus larges, contribuent puissamment à enrichir, voire à modifier, l’histoire du monachisme féminin. Elizabeth Rapley a joué, à cet égard, un rôle important depuis son ouvrage sur les dévotes dans la France du XVIIe siècle, publié en 1990. A Social History of the Cloister est un ouvrage majeur. L’auteure a suivi, pendant deux siècles, l’histoire de trois congrégations féminines enseignantes, la Compagnie de Sainte-Ursule, la Compagnie de Marie Notre-Dame et la Congrégation Notre-Dame, certes différentes à bien des égards les unes des autres, mais qui, néanmoins, participent ensemble et de plein droit à un projet religieux. Après s’être d’abord attachée à retracer l’histoire du monachisme français moderne, depuis son apogée au XVIIe siècle, jusqu’à son déclin et à sa disparition à la fin du XVIIIe siècle, et dont elle examine soigneusement les multiples facettes, elle multiplie les angles d’investigation de façon à dessiner, de la manière la plus complète, la vie des trois communautés et de leurs membres : relations souvent tendues avec les évêques, faisant ainsi un sort à la prétendue docilité des religieuses – un vieux cliché –, particulièrement visible au moment de la crise janséniste, les questions financières, le fonctionnement interne des couvents, le respect des règles monastiques, la nature des vocations religieuses, la formation des novices, la spiritualité de la mort, la fonction enseignante. Fondé sur un dépouillement exhaustif des sources imprimées et manuscrites et sur une connaissance approfondie de la bibliographie, cet ouvrage trace brillamment le portrait du monachisme féminin, à son niveau le plus bas : le couvent, et, à son plus élevé : l’ordre, à la fois dans sa vie quotidienne, dans son évolution historique et dans la perspective plus générale de l’histoire de l’Église de France sous l’Ancien Régime. Un précieux appendice sur la démographie du cloître et un glossaire des termes monastiques les plus usités complètent l’exposé. Un ouvrage indispensable par son contenu et sa méthodologie, écrit en outre dans un style élégant, pour tous ceux et celles qui entreprendront désormais des recherches sur un sujet qui demeure largement à approfondir.